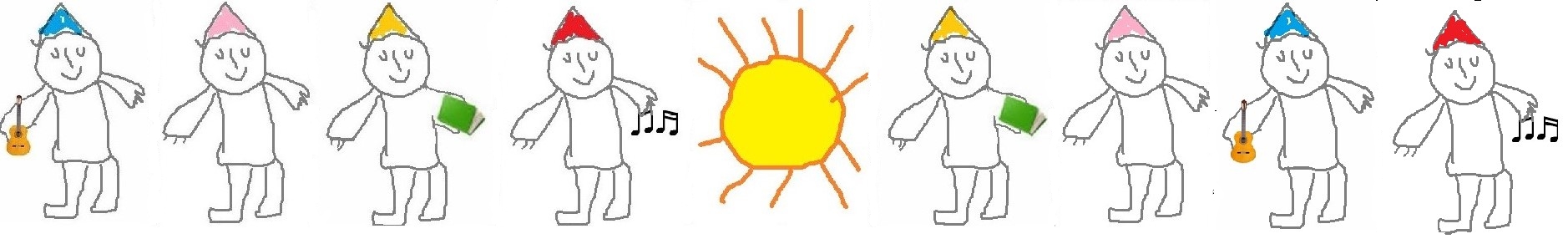Jean-Yves Bosseur
et les musiques vertes
Entretien avec le compositeur Jean-Yves Bosseur, autour d’un travail de "musiques vertes" réalisé avec Christine Armengaud.
(Voir l'entretien avec Christine Armengaud )
J’ai rencontré l’ethnologue Christine Armengaud au début des années 80 dans le Luberon, pour un projet de « Musiques vertes » dont elle était l’initiatrice. Elle menait des enquêtes auprès des personnes âgées en vue de trouver le mode de fabrication de ses instruments végétaux, faits avec les éléments de la nature. Même si le mode de jeu s’était presque totalement perdu, cela permettait de valoriser un patrimoine oublié sinon méprisé, et de le remettre en valeur. Patrimoine qui n’était pas au départ destiné à faire de la musique, mais qui servait plutôt comme appeaux pour la chasse, ou quelquefois comme jouets pour les enfants.
Le projet était d’aller auprès des enfants, pour qu’ils construisent les instruments et ensuite puissent en jouer.




Nous avons assuré beaucoup d’animations en milieu scolaire, avec des enfants entre 6 et 12 ans.
D’abord Christine construisait des instruments avec des animateurs et avec les enfants, et ensuite je les testais avec eux.
Je leur faisais faire des jeux pour appréhender des notions comme : son tenu, son régulier, répété, continu, etc., ou celles de point, ligne, surface. Puisque ces instruments ne sont pas très stables, je trouvais plus intéressant de travailler sur leur timbre, ou sur les modes d’attaques, que sur les hauteurs, qui sont aléatoires.
Ensuite, je leur proposais un scénario, comme un synopsis d’actions et réactions sonores, quelquefois des partitions en forme de texte.
Ce sont des propositions pour des instruments éphémères, je donnais un canevas ; c’était une partition ouverte dans laquelle les enfants avaient le loisir d’inventer leur musique.



Ensuite, nous avons enregistré, avec les enfants et les animateurs, un 45 tours. Le choix de ce format était dû à l’ornithologue et bioacousticien Jean Roché, qui avait un studio d’enregistrement et qui considérait que les aigus si particuliers de ses instruments sortiraient mieux ainsi.
Il était produit par l’association « Musiques vertes » créé par Christine Armengaud, mais nous n’avions pas de diffuseur, si ce n’est que le bouche à oreille, et plus récemment un disquaire du marché aux puces de Saint-Ouen.
Et à ma grande surprise, tout récemment, une maison de disques italienne spécialisée dans les productions expérimentales, m’a demandé de le rééditer. Cela m’a fait très plaisir.
Ce qui m’intéressait dans ce travail c’était de faire de la musique, avec une certaine structure, et non pas d’explorer pour explorer, sans une autre finalité.
Je trouvais intéressant de travailler sur ces instruments dans une démarche de compositeur, d’avoir un intérêt musical. Les instruments se prêtaient très bien, il fallait inventer, il n’y a pas de répertoire, si ce n’est que reproduire un oiseau, sans essayer d’imiter des choses existantes. Il faut inventer la musique, c’est le son.
C’était une belle expérience !


Voici quelques explications sur le travail de certains morceaux.
A la lisière des bruits
Selon un code de gestes, un coordinateur oriente le jeu de ses partenaires en ce qui concerne !
• Le mode d’attaque et la durée des sons (de sons ponctuels à des sons ténus)
• Le degré d’activité et la densité des intervenants
• La situation des sons les uns par rapport aux autres.

La boucle des bruits
Partir de la gauche ou de la droite de la boucle ci-dessous et la parcourir en progressant aussi ensemble que possible d’une situation à une autre. Il est possible de réaliser une version de la boucle pour laquelle le groupe se diviserait en deux parties, chacune suivant un cheminement différent mais se retrouvant un moment ensemble au centre de la boucle. Il est également envisageable de traduire spatialement la boucle et de provoquer ainsi des déplacements des participants, d’une étape à une autre.

La boucle de bamboo
Une boucle représente un trajet suivi par les musiciens et déterminé non par les gestes d’un coordinateur, mais par une figure graphique que les participants doivent suivre ensemble en s’écoutant, et dont le parcours de lecture peut être celui indiqué dans la figure ci-dessous.
NB : chaque étape doit être préparée séparément avant de susciter un parcours où les phases successives se substituent insensiblement les unes aux autres.

Ton sur ton
Souligner à peine les sons de l’environnement naturel en « prenant en charge » un élément (chant d’oiseau, bruit du vent dans les feuilles, ruisseau…) et en s’efforçant de prolonger ce que l’on perçoit ; jouer sur des effets de décalage, d’éloignement par rapport aux sources sonores de référence ; réaliser des transitions entre les différents signaux. Chercher des représentations graphiques (à l’aide de points, lignes, trames) pour certains éléments sonores enregistrés (chant d’oiseaux, bruits d’eau), à la manière d’une notation sténographique. Imaginer des développements de ces chants, de ces bruits, en s’aidant des suggestions graphiques. Rediffuser l’enregistrement d’origine et lui superposer un parcours sonore à partir des graphismes ainsi obtenus en intervenant au moment où l’on perçoit les phénomènes sonores que l’on a tenté de noter (les participants peuvent se partager les évènements sonores les plus repérables dans l’enregistrement et développer leurs interventions graphiques et sonores à partir d’eux).
Jean-Yves Bosseur, compositeur, musicologue, écrivain, a étudié la composition avec Henri Pousseur et Karlheinz Stockhausen à Cologne à la Hochschule für Musik Kölnde, et a obtenu son doctorat d’État (philosophie esthétique) à l’Université de Paris I
Directeur de recherche au C.N.R.S. et professeur de Composition musicale au CNR de Bordeaux jusqu’en 2013.
Prix de la Fondation Royaumont (France), de la Fondation Gaudeamus (Pays-Bas).
Diapason d’or de l’année 1998 pour la Messe.
Élu associé à l’Académie royale de Belgique en 2014.
Il a composé plus de 200 œuvres.
Nous remercions Jean-Yves Bosseur et Christine Armengaud de nous avoir autorisées à publier les photos et les enregistrements.