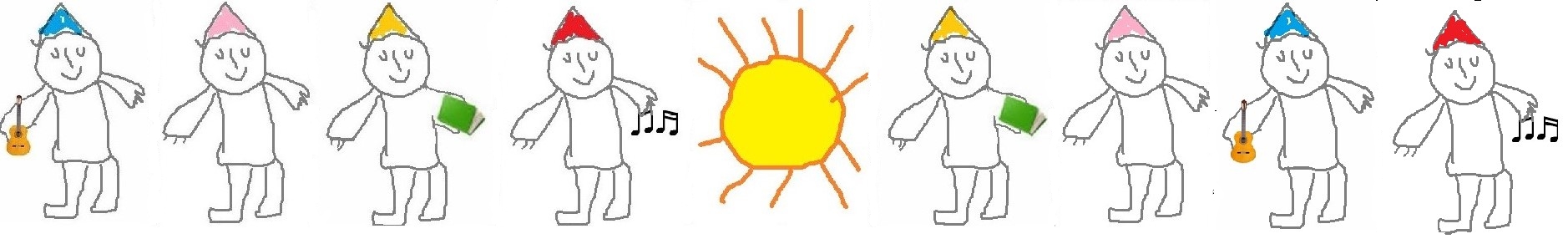Milo Darnaud pédagogue et artiste
Après des études classiques de violon, Milo découvre la danse traditionnelle et la liberté de se détacher des partitions, rompant ainsi avec un carcan qui limitait sa créativité.
La découverte d’un monde associatif libre et solidaire devient alors un véritable moteur pour développer ses projets personnels et pédagogiques.
Il s’engage également contre toutes les formes de discriminations, dans une dynamique féministe et intersectionnelle.
Il répond à nos questions.
Bonjour Milo.
Vous êtes violoniste de formation classique. Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers les musiques traditionnelles et les bals ?
J’ai découvert pour la première fois le bal il y a une dizaine d’années quand des ami·e·s du conservatoire m’ont invité à venir à un bal.
J’ai été touché en premier par la danse. Il y avait quelque chose de beau à voir toutes ces personnes danser ensemble. C’est devenu pour moi une nouvelle manière d’échanger, de partager. La danse m’est d’abord apparue comme une pratique sociale et collective.
En parallèle de la danse, j’ai commencé à sortir mon violon en bœuf. C’était très éloigné de ma pratique au conservatoire : apprendre le morceau en collectif, en direct, sans partition. J’étais habitué à ce qu’il existe une “vraie” version des morceaux, une “vraie” justesse, une “vraie” position de jeu… J’ai découvert un univers des possibles qui m’a beaucoup plu. Ça m’a amené à travailler l’apprentissage d’oreille, le ressenti de la pulsation, l’écoute collective. C’était déboussolant de changer de jeu d’archet, d’ornementations, d’expérimenter d'autres hauteurs de notes et en même temps, c’était très plaisant. J’avais l’impression de redécouvrir mon instrument.
Il y a le lien entre la musique et la danse. Le mouvement des corps et la cadence des mélodies qui sont intriqués et se nourrissent mutuellement. Ça me plaît de jouer de la musique pour et avec les danseureuses. Les personnes qui ne sont pas sur scène, qu'on peut qualifier de public, font partie intégrante de ce qu'il se produit. Il y a un échange permanent entre la salle et la scène. La frontière est très poreuse : les danseureuses chantent, font des frappés de pieds et parfois crient pour exprimer leurs émotions. Quand je joue de la musique tout seul chez moi, il m'arrive d'imaginer des personnes danser pour m'aider à phraser mon jeu.
Il y a aussi le rapport au présent. Ces musiques sont toujours actuelles. Pour moi, ça va à contresens de la notion de progrès, de modernisme, de consommation. Ces musiques ne sont jamais dépassées.
Il y a toujours de nouvelles mélodies, de nouvelles variations, de nouvelles interprétations qui ne seront pas plus importantes parce qu'elles sont nouvelles mais au même endroit que les autres pour ce qu’elles disent de la personne qui les joue et ce que dit cette personne en les jouant.
Je joue dans le groupe MUR·MUR, rencontre de quatre musicien·ne·s qui tissent un pont entre les répertoires du Centre France, du Massif Central et du Poitou. Oscillant entre collectages et compositions, iels évoluent dans le paysage des musiques modales et actuelles pour proposer un répertoire de bal varié, au service de la danse. L’instrumentarium éclectique – banjo, violon, voix, accordéon, saxophone et synthétiseur – invite à l’expérimentation. Dans l’assemblage des timbres et la recherche de textures sonores, les bourdons et les mélodies s’entremêlent aux chants. MUR·MUR ça écorche les genoux et ça met du baume au cœur.
Et puis c'est un milieu qui repose sur de l'associatif et principalement du bénévolat où la notion d’éducation populaire est très présente. Par exemple dans la transmission de la musique par la pratique du bœuf qui est un lieu d'apprentissage intergénérationnel où les musicien·ne·s partagent et s'influencent, apprennent ensemble. Mais également dans toutes les autres composantes des événements autour du bal (cuisine, administratif, bricolage, ménage...). Il y a aussi un partage et une transmission des savoirs à ces endroits-là. Les personnes dont le travail rémunéré est de faire ou de transmettre de la musique ou de la danse sont, pour la majeure partie, également investies dans des associations et participent à l'organisation collective des événements.

Vous êtes titulaire du DUMI et intervenez en milieu scolaire auprès des enfants et des enseignants. Comment votre démarche est-elle accueillie ?
Pour moi, ce n'est pas une fin en soi que les élèves sachent chanter ou danser. Faire de la musique et de la danse en milieu scolaire, c’est un moyen de créer de la dynamique de groupe, d’amener les élèves à s’exprimer, écouter, prendre conscience de l’individu et du collectif. Ce que j’aime quand je travaille avec des classes, c’est de voir des élans collectifs qui naissent. Par exemple, quelques élèves commencent à chanter une chanson et le reste de la classe la reprend ensemble. Il y a un plaisir à faire ensemble, et la musique ou la danse est le moyen de partager ces espaces. C’est une démarche qui est bien accueillie. Elle permet de faire le pont entre s'exprimer individuellement et vivre en groupe-classe.
Vous avez intégré l’association Les Brayauds, née en 1980, devenue le Centre départemental des Musiques et Danses Traditionnelles du Puy-de-Dôme, où vous êtes très impliquée. Comment décririez-vous votre rôle au sein de cette structure ?
L’association Les Brayauds-CDMDT63 fourmille d’initiatives et d’activités. Il y a 11 personnes salariées et autour de 80 bénévoles actif·ve·s tout au long de l'année sans compter les dizaines de bénévoles qui se rajoutent durant les festivals. L'implication des personnes est souvent multiple et variée et elle évolue avec le temps.
Pour ma part, j’ai travaillé à l’école de musique associative et pour l’orchestre à l’école en lien avec l’école élémentaire du village de Saint-Bonnet-près-Riom. Je co-anime le stage de violon du festival Les Volcaniques. J’ai fait du bénévolat dans les bals et les festivals (organisation, buvette, consigne…). J’ai coordonné le dispositif Tradamuse et la création du répertoire Fanmirette (écriture du livret pédagogique et enregistrement d'un double CD avec la participation de 28 musicien·ne·s de l'association). Je fais également parti d'un groupe de bal Brayauds qui s'appelle Triplette avec qui j'ai enregistré un CD l'année dernière, nous jouons principalement dans le Massif Central et en France. J’ai fait partie de l’équipe pédagogique et artistique de la formation Mesclar. J’anime des formations, à destination des enseignant·e·s autour de la construction d’ateliers de danse pour enfants. Je participe à des projets d’actions culturelles en milieu scolaire sur le département du Puy-de-Dôme et en dehors. Je fais partie de la commission VHSS qui met en place des outils pour lutter contre toutes les formes de discriminations dans une dynamique féministe et inter-sectionnelle.

Vous avez enseigné le violon à l’école de musique de l’association. Quels étaient les axes essentiels de votre pédagogie ?
C’est une école de musique où la pratique sociale et collective a beaucoup d’importance. Le cursus des élèves est construit autour de cet axe. Une semaine sur deux, iels sont en atelier collectif où tous les instruments sont mélangés. Durant ces ateliers, il y a de l’apprentissage de mélodies, de l’arrangement, de l’écoute musicale, du chant et de la danse.
Ces ateliers permettent aux élèves de : – Comprendre comment fonctionnent les autres instruments, quelles sont leurs possibilités et contraintes de jeu (volume sonore, mode de jeu, ambitus…). – Décider ensemble dans la construction de la structure des morceaux. Ce qui amène à discuter, débattre, essayer une version, exprimer son avis. – Développer l'écoute collective : démarrer, s’arrêter, adapter son tempo… L'objectif est d'amener les élèves à gagner petit à petit en autonomie et à terme à monter leur propre groupe de musique.
La semaine suivante, les élèves sont en cours instrumentaux où iels peuvent revoir plus en détails les mélodies ou leurs parties d’arrangements.
Les formateurices de l’école de musique construisent les séquences et mènent les ateliers collectifs ensemble. Ainsi, chaque formateurice connaît tous·tes les élèves de l’école de musique. Ce qui est plus facile pour créer des groupes, savoir si la dynamique collective va plus ou moins bien fonctionner.
En plus de cette alternance, avant chaque vacance scolaire, il y a un “mercredi d’activités collectives” où les élèves, en plus de la musique et de la danse, cuisinent ensemble et font des activités manuelles et artistiques. Ce qui permet aux élèves de partager d’autres moments et de se socialiser en dehors de leur pratique instrumentale.
Pour permettre aux élèves d’expérimenter le bal et de faire danser, il y a des inter-plateaux qui sont réservés pour l’école de musique lors des bals qui ont lieu tout au long de l’année au Gamounet.


Vous coordonnez également le dispositif Tradamuse, qui met en lien enfants, enseignants et parents autour de la musique traditionnelle. Pouvez-vous nous expliquer son fonctionnement et ses objectifs ?
Le dispositif Tradamuse s'adresse aux écoles maternelles et élémentaires du Puy-de-Dôme. Les professeurs des écoles inscrivent leur classe entre septembre et octobre. En novembre, iels suivent trois ateliers où iels apprennent le répertoire de danse adapté en fonction de l'âge des enfants. Puis iels transmettent les danses à leurs classes. À la fin de l'année scolaire, entre mai et juin, il y a un bal dans chaque école où les familles sont conviées. Les élèves apprennent alors à leur famille à danser. C'est un moment très convivial où les rôles habituels s'inversent.
Ce dispositif a pour objectif de créer des chaînes de transmission : entre les professeurs des écoles, entre les professeurs des écoles et leurs élèves, entre les élèves, entre les élèves et leur famille. Cela crée des échanges, du partage, des espaces où l'on peut apprendre ensemble, grandir, écouter, s'affirmer, interagir, mieux comprendre l'autre. Il y a aussi une dimension d'expression artistique à travers les danses et les chants.


Vous avez récemment coordonné la publication de Fanmirette – Répertoire de bal pour enfants, composé d’un CD et d’un livret pédagogique. À qui s’adresse ce projet et comment peut-il être utilisé ?
Ce projet s'adresse :
- Aux professeurs des écoles qui souhaitent chanter, danser ou écouter de la musique avec leur classe et/ou organiser un bal pour la fête de l'école.
- Aux musicien·ne·s intervenant·e·s qui construisent un projet autour des danses et chansons traditionnelles.
- Aux professeurs de musique qui cherchent du répertoire pour leurs élèves de chant ou d'instruments.
- Aux animateur·ice·s de péri-scolaire qui veulent mener des activités collectives.
- Aux parents et aux familles qui ont envie d'écouter de la musique dans la voiture et de danser dans le salon avec leurs enfants.
Plus largement, ce projet s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent écouter de la musique, danser, chanter.
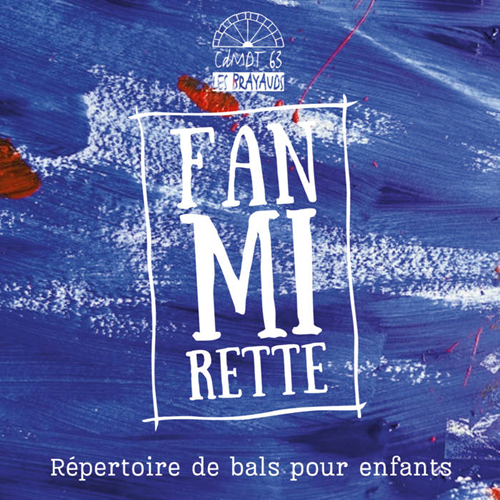
Enfin, comment imaginez-vous l’avenir de vos actions autour des musiques traditionnelles et de l’oralité ?
J'ai envie de continuer à politiser ma pensée et mes actions autour des musiques traditionnelles. Je travaille à créer du lien entre mon positionnement politique et mes pratiques de transmissions et d'expressions artistiques. Le fait d'être assigné femme la majorité du temps, de me définir trans non-binaire et de faire de la scène est loin d'être anodin dans une société patriarcale. La scène des musiques traditionnelles est principalement occupée par des hommes cisgenres blancs. En d'autres termes, elle n'échappe pas aux discriminations systémiques. Comme je suis une personne sexisée, c'est un travail quotidien supplémentaire de se faire une place. J'ai envie de continuer à agir pour permettre plus d'égalité et de reconnaissance des violences. J'aimerais que ce milieu soit plus accessible pour toutes les personnes discriminées par le racisme, le sexisme, le validisme, l'homophobie, la transphobie et toutes les autres formes d'oppressions.
Il y a déjà plein d'initiatives dans ce sens : les actions du réseau Anti-sexisme trad (comptage, annuaire des musicienne·x en partenariat avec la FAMDT), les programateur·ice·s qui font attention à la mixité dans leur programmation, le collectif Matières Vivantes, As Queer as Folk, les bals au centre lgbt de lyon, Queeralité, les ateliers de danses non genrés, les affichages anti-discrimination dans les festivals…

Je vous remercie.
Cristina Agosti-Gherban
Sons - Videos
L'album de Triplette : bandcamp
L'EP de MUR·MUR : soundcloud
3 vidéos de moi-même en solo :
Milo Darnaud - Bourrée à Chabrier / Las drollas de Lonzac / Trist’ annada
🎬 Si la vidéo ne s'affiche pas, cliquez ici pour la regarder sur YouTube .
Pour compléter cette lecture, vous pouvez
écouter l’interview à Eric Champion,
un des membres fondateurs de l’association Les Brayauds.
Retrouvez la chronique de l’album Famirette, coordonné par Milo Darnaud, dans nos sélections Livres/Méthodes